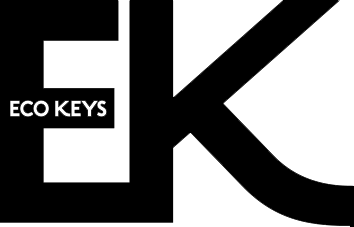BERTRAND PICCARD, L’EXPLORATEUR AUX 1 000 SOLUTIONS
En 2015, il réalisait le premier tour du monde à bord d’un avion solaire. Aujourd’hui, le visionnaire suisse milite contre la décroissance et le gaspillage.
« Les héros de la planète sont ceux qui explorent d’autres manières de faire et de penser pour améliorer la qualité de vie pour l’humanité. »
C’est dans cet état d’esprit que Bertrand Piccard va entamer son troisième tour du monde. Après ses exploits d’aventurier, à bord du Breitling Orbiter, sa montgolfière, puis Solar Impulse, son avion à propulsion solaire, le pionnier se lance dans une nouvelle quête : sauver la planète. Cinq années de travail acharné ont permis au « savanturier » suisse de relever le défi qu’il s’était lancé à la COP22 de Marrakech. Il a identifié et labélisé les 1 000 solutions technologiques financièrement rentables pour protéger l’environnement. Face aux discours pessimistes assimilant écologie et décroissance, Bertrand Piccard aborde la protection de l’environnement de manière positive: « Il y a de l’espoir mais il faut avancer, il faut que les gouvernements prennent leurs responsabilités, il faut qu’ils répondent à tous ces besoins avec des moyens innovants, pionniers en utilisant les solutions d’aujourd’hui et non les vieux systèmes d’avant-hier. »
« J’ai été élevé dans l’exploration utile, pas dans l’aventure gratuite. »
Pionnier humaniste
L’exploration scientifique destinée à améliorer la qualité de vie sur la planète fait partie de son héritage familial : « J’ai été élevé dans l’exploration utile, pas dans l’aventure gratuite. » Son grand-père, Auguste, invente le ballon stratosphérique, en 1931, pour montrer que les avions pourraient monter plus haut dans de l’air raréfié et consommer moins de carburant. Son père, Jacques, descend, en 1960, à 11000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes pour prouver qu’il y a de la vie au fond des fosses marines, là où les gouvernements voulaient jeter leurs déchets radioactifs. Ce descendant d’une lignée d’explorateurs, animé par l’esprit pionnier, combine exploration scientifique, protection de l’environnement et recherche d’une meilleure qualité de vie : « J’ai réalisé que le dernier domaine à explorer était l’être humain. » L’humaniste, cofondateur et président de la fondation humanitaire Winds of Hope, se définit comme un être social, et plaide pour une croissance qualitative.
Vivre dans l’incertitude, le questionnement, est un héritage provenant de sa mère. C’est cette figure maternelle, pianiste virtuose, avec qui, enfant, il questionnait le monde, qui lui permettra de s’extraire de son héritage paternel pour se lancer dans les études de psychologie. Entre une mère spirituelle et un père inventeur, ce philosophe pragmatique oscille entre monde intérieur et extérieur. Il met l’accent sur l’importance des balbutiements, de lâcher du lest.
C’est ce qu’il a appris en pilotant son ballon. Adepte de l’hypnose, taoïste, bercé par les préceptes psychanalytiques, l’explorateur en série, animé par le dépassement de soi, utilise ses doutes pour stimuler sa créativité.
Réconcilier pour mieux vivre
Opposé à l’esprit clivant qui, selon lui, conduit au désastre, le visionnaire écopragmatique apporte aujourd’hui des solutions concrètes au désastre environnemental et privilégie les propositions fédératrices. Convaincu qu’écologie peut rimer avec rentabilité, il a développé des idées qui allient enjeux climatiques et intérêts économiques afin de réconcilier écologie et industrie.
Transformer la catastrophe climatique en opportunité économique et industrielle, voilà sa vision positive du développement durable. Il propose alors d’accompagner les grandes entreprises dans leur transition écologique plutôt que de les stigmatiser. « Stimulons l’innovation, stimulons cet esprit de pionnier qui consiste à se remettre en question dans nos certitudes pour nous ouvrir à de nouvelles solutions inconnues aujourd’hui qui donneront quelque chose pour demain. » Pour prouver que la protection de l’environnement peut être profitable et créatrice d’emploi, sa fondation Solar Impulse a collaboré avec des start-ups, des laboratoires de recherche et des grandes entreprises pour sélectionner les 1000 solutions. Chaque innovation se veut crédible et faisable dès à présent, avec une approche environnementale novatrice et un bénéfice pour l’entreprise comme le client.
Croissance responsable
Parmi les solutions labélisées, l’entreprise française, Waga Energy, a mis au point un système qui capte le méthane, puissant gaz à effet de serre que relâchent les décharges publiques pour le réinjecter dans le réseau de gaz. Ou encore Carbiolice, française elle aussi, a conçu une enzyme capable de rendre certains plastiques 100% compostables.
Pour Bertrand Piccard, une urgence aujourd’hui, lutter contre la pollution automobile, comme le propose la société française Antismog. Cette dernière a créé un boîtier à hydrogène qui s’adapte à tous types de véhicules pour réduire de 80 % les rejets de particules toxiques et diminuer de 20 % la consommation de carburant. L’explorateur plaide pour une « rentabilité sociale », et non uniquement capitalistique. Avec les solutions qu’il a labélisées, il assure permettre aux consommateurs d’être plus efficients et d’augmenter le pouvoir d’achat en gaspillant moins et en protégeant l’environnement. Au centre de son discours, lutter contre le gâchis, considérer les déchets comme des ressources et créer des emplois et du profit en remplaçant ce qui pollue par des produits respectueux de l’environnement. Il s’agit alors de mettre la technologie au service du développement durable pour favoriser une croissance économique propre. Mais aussi de soutenir les solutions efficientes « logiques » avant d’être écologiques. Un programme optimiste et prometteur. Mais le dernier projet de l’explorateur n’est pas destiné à rester un simple catalogue.
La prochaine étape ? « Je vais entamer un tour du monde des solutions où j’irai apporter notre guide à tous les chefs d’État. »
CLARISSE CRÉMER, L’ÉTONNANTE SKIPPEUSE
Cinq ans après son entrée dans le monde de la voile, la navigatrice est devenue la femme la plus rapide de l’histoire du Vendée Globe, et elle ne compte pas s’arrêter là. Portrait d’une compétitrice acharnée.
Elle n’est pas la plus célèbre des navigatrices mais elle est sans doute la plus solaire. Avec son franc-parler et son sourire, Clarisse Crémer incarne une nouvelle génération de skippers, très loin de l’image bourrue du marin. À 31 ans, la jeune femme est devenue le visage marquant du Vendée Globe 2020-2021. Il faut dire que celle que certains surnomment « la machine » a réussi un exploit: boucler l’Everest des mers en 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes, à bord du monocoque IMOCA de Banque Populaire. Arrivée à la 12e place, elle est également la nouvelle détentrice du record féminin.
Trois mois passés seule en mer, qu’elle décrit comme une parenthèse hors du temps : « C’est une aventure extrême qui m’a permis d’apprendre beaucoup sur moi. Je me suis rendu compte du pouvoir du mental et de ma capacité à occulter la détresse psychologique. »
Une Parisienne née loin de la mer
Et pourtant rien ne la prédestinait à un avenir au large des mers et, encore moins, à un destin de skippeuse professionnelle.
Née à Paris en 1989, la petite dernière d’une famille de quatre enfants grandit à Saint-Cloud en région parisienne et s’initie à la voile pendant les vacances chez ses grands-parents, entre la Bretagne et les îles normandes. « Dans ma famille, on adorait le bateau, mais on n’en possédait pas. C’est par le biais de mes études que j’ai vraiment découvert la voile. J’ai eu pas mal d’opportunités pour apprendre à naviguer et côtoyer le monde professionnel.
Résultat, quand je suis rentrée à l’école, je passais plus de temps à naviguer qu’à étudier », raconte-t-elle.
À l’école, elle est une élève modèle : un bac S mention très bien dans un lycée réputé de Rueil-Malmaison, une classe préparatoire à Versailles puis HEC, où elle arrive à garder le contact avec la mer en intégrant le club de voile de l’école. Dès la fin de ses études, elle crée, avec son frère Jérémie, une start-up de séjours en plein air. Avec un père fondateur du site meilleurtaux.com et une mère engagée dans plusieurs associations, la famille a l’âme entrepreneuriale.
À cette époque-là, Clarisse travaille à Paris la semaine et part respirer le weekend en Bretagne pour retrouver son compagnon, le skipper Tanguy Le Turquais. Mais l’appel du large se fait de plus en plus fort. Le déclic intervient en décembre 2014 dans un bureau de la Sécurité sociale lorsque Clarisse se demande : « Qu’est-ce que je fais là ? »
Un ovni dans le monde de la voile
Trois mois plus tard, elle quitte la région parisienne et rejoint Lorient pour se lancer, elle aussi, dans la course au large. « Je ne savais pas très bien où ça allait me mener. J’ai seulement suivi une passion que j’avais au fond de moi. J’ai eu beaucoup de chance car mon entourage a compris mes choix », confie-t-elle.
« Quand je suis rentrée à l’école, je passais plus de temps à naviguer qu’à étudier. »
Tout va ensuite très vite. Une formation accélérée avec Tanguy Leglantin, un entraîneur breton très réputé, puis une première régate en solitaire et en 2017, la Mini-Transat, où elle réalise un exploit. Pour sa première course au large en solitaire, Clarisse décroche une incroyable deuxième place et se révèle aussi bonne navigatrice que communicante. Car la jeune femme n’hésite pas à se raconter. Grâce à ses vidéos décalées, la skippeuse dévoile avec humour les coulisses de sa vie de coureuse au large.
Rien n’est passé sous silence, ses faiblesses comme ses fiertés. « Ma caméra fait partie de mon soutien psychologique.
Je me rattache à ça, c’est une motivation supplémentaire », dit-elle. Avec son style bien à elle, Clarisse étonne, voire détonne, dans ce milieu très masculin. En a-t-elle souffert ? Pas vraiment. « Être une femme ça peut aussi être une chance et ça peut permettre de convaincre des sponsors », explique-t-elle.
Une formation accélérée
Convaincu, Ronan Lucas, le directeur du Team Banque Populaire, l’a été immédiatement. Séduit par le profil atypique de Clarisse, il lui propose de faire le mythique Vendée Globe.
L’annonce fait réagir alors que certains marins attendent leur tour depuis des années. « Il y a eu des critiques et je les comprends : je me suis retrouvée propulsée dans ce qui se fait de mieux en matière de course au large », raconte t-elle. Qu’importe, la jeune femme est déterminée. Après quelques jours de réflexion, le défi est accepté. Pas d’objectif de victoire mais l’envie d’apprendre et de se dépasser. Pendant un an et demi, Clarisse travaille d’arrache-pied auprès d’Armel Le Cléac’h, vainqueur du Vendée Globe 2016. Son « mode d’emploi vivant », comme elle le surnomme. C’est à ses côtés que la navigatrice participe à la Transat Jacques Vabre 2019. Une première course au large en IMOCA sous forme de répétition pour la jeune femme. Un an après, Clarisse quitte les pontons des Sables d’Olonne, presque comme une évidence. À son retour, elle racontera son bonheur immense d’avoir relevé ce défi, tout comme ses moments de détresse, ou encore les mauvaises surprises rencontrées sur les océans : « Tu es au milieu de nulle part et tu croises une bouteille de lessive en train de flotter, c’est assez choquant. » Car le sujet la préoccupe : « Je suis très ambivalente sur la question, très engagée au quotidien mais en même temps, j’ai conscience que quand on fait de la course à voile, ça a un impact sur l’environnement », explique-t-elle.
À quoi rêve-t-elle maintenant ? Difficile d’y répondre, elle n’aurait jamais imaginé tout ça, il y a cinq ans. Sans doute « y retourner» mais aussi fonder une famille : « J’ai l’ambition de concilier les deux, il faut juste parvenir à convaincre un sponsor que c’est possible. »
JEAN-LOUIS ÉTIENNE, EXPLORATEUR DANS L’ÂME
À 75 ans, ce pionnier de l’exploration polaire n’a pas fini de nous surprendre. Il s’attaque aujourd’hui à l’océan Austral, un projet ambitieux à l’image de cet homme toujours animé par ses rêves d’enfant.
Il est l’un des derniers grands aventuriers de notre époque. « En 2026, à la fin de l’aventure Polar Pod, j’aurai 80 ans ! », lance-t-il. L’infatigable médecin explorateur a imaginé un immense navire vertical capable de supporter les houles géantes de l’océan Austral. Ce dernier retient 50% de la quantité de gaz carbonique absorbé par l’ensemble des océans de la planète. Jean-Louis Étienne souhaite y faire l’inventaire de la faune marine aux quatre saisons. Trois ans à se laisser dériver dans ce vaisseau révolutionnaire, l’équivalent de deux tours du monde. Une nouvelle aventure dans l’immensité d’un environnement rude et désolé.
L’appel des pôles, une quête de soi
C’est le froid qui a attiré ce passionné d’alpinisme vers les régions polaires mais aussi une quête intérieure profonde avec « l’ambition d’avoir une vie forte ». Fasciné par la montagne depuis toujours, il voit dans la nature un refuge, une échappatoire. « J’aimais être à l’extérieur, camper, et donc cet engagement pour le grand dehors a toujours été là. » Dyslexique, sans grand attrait pour l’école, il débute une formation de tourneur-fraiseur avant de se lancer dans les études de médecine. Il se passionne alors pour la chirurgie dans laquelle il voit un lien entre médecine et geste manuel. Sa rencontre avec le père Jaouen, en 1974, lui fera découvrir la mer.
Spécialiste de nutrition et de biologie du sport, son métier est alors son passeport pour l’aventure. Patagonie, Himalaya, Groenland… il participe à de nombreuses expéditions et accompagne Éric Tabarly pour la course autour du monde à la voile sur Pen Duick VI. L’envie de créer son histoire le décide à organiser sa première expédition, seul. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire après soixante-trois jours de marche.
Il décrit cet exploit hors norme comme « une quête spirituelle personnelle profonde ».Trois ans plus tard, il réalise la plus longue traversée du continent Antarctique lors de son expédition internationale Trans-Antarctica, sept mois à parcourir 6 300 km en traîneaux à chiens. Des projets toujours plus intenses guidés par cette volonté de se réaliser soi-même.
Sa force intérieure lui vient du « Dieu des pôles », dit-il. Arpenter les régions polaires implique de passer du temps avec soi, de vivre une intériorité profonde et d’explorer son existence. Ce spécialiste de l’auto-confinement voit alors dans l’isolement une richesse, la possibilité de retrouver son libre arbitre, un chemin d’apaisement.
« En 2026, à la fin de l’aventure Polar Pod, j’aurai 80ans ! »
L’exigence au cœur de l’expédition
Marcher sur la banquise chaotique par -52 °C et se retrouver face à ces murailles de glace, voilà le quotidien de Jean-Louis Étienne lors de ses expéditions dans les régions polaires. Comment résister à la tentation de l’abandon? « Rester concentré », « persévérer », et « découvrir ses limites » avec toujours l’ambition de rejoindre son désir, « son réacteur de rêve ». Quand il évoque sa première traversée au milieu de l’océan gelé, l’aventurier spirituel dit avoir fait appel à une force extérieure : « J’étais un pèlerin qui demandait humblement le passage. » Autodidacte et autonome, l’homme est tenace depuis l’enfance. À 14 ans, il veut apprendre la guitare mais ne peut s’en offrir une. Qu’à cela ne tienne, il construira sa première guitare et fera ses gammes en solitaire. Il décrit l’exigence comme étant le minimum requis pour réaliser ses rêves. « Affronter l’incrédulité, la méfiance, le déni, est le prix de toute idée neuve. Le découragement est un test permanent à franchir sinon rien ne se réalise. »
Passionné de rugby, ce loup solitaire qui affectionne le silence et le bruit du vent, aime être porté par le groupe et oscille entre isolement et travail d’équipe.
L’exploit utile
Si l’introspection fait partie de ses moteurs, le désir de transmettre et d’éveiller les consciences anime ses missions :
« J’adore raconter des histoires et je trouve que l’aventure est une passerelle formidable entre la science, l’environnement et le public. » Infatigable défenseur de la planète et des régions polaires, Jean-Louis Étienne garde toujours en tête la vocation pédagogique de ses missions.
Avec son voilier, Antarctica, il mène dix années d’expéditions polaires pour expliquer le rôle fondamental que ces régions jouent sur l’équilibre du climat de la Terre. En 2002, dans le cadre de la « mission banquise », il s’isole plusieurs mois dans le Polar, pour observer un module dérivant afin d’étudier la fonte de la banquise. Et il réalise, en 2010, la traversée du pôle Nord en ballon pour attirer l’attention du Monde sur la catastrophe planétaire qu’engendrerait la disparition de la banquise. « Je suis devenu un passeur d’informations », dit-il.
Mais s’il veut alerter, il souhaite également insuffler une dose d’espoir parmi les discours pessimistes ambiants car même si le chemin est long, il perçoit des solutions. Trouver les mots simples et percutants pour convaincre hommes politiques et entreprises fait partie de ses ambitions : « On a l’intelligence des solutions mais nous n’avons pas la sagesse de leur mise en œuvre. »
Sa prochaine expédition sur sa station océanographique internationale devrait permettre de découvrir l’océan Austral, acteur majeur de l’équilibre climatique mondial. Sans motorisation, entraîné par le courant circumpolaire et les vents d’ouest, alimenté par six éoliennes, Polar Pod est un navire « zéro émission ».
Son financement est toujours à l’étude dans un partenariat public-privé qui verra collaborer de grandes entreprises françaises avec des institutions scientifiques internationales. Celui qui voit la mort
comme une exploration décrit le Polar Pod comme « sa cathédrale », un rêve qui devrait voir le jour dans quelques mois.
DEBORAH PARDO, DE L’ANTARCTIQUE AU LEADERSHIP
Docteur en écologie des populations, la jeune femme s’était lancée dans une prestigieuse carrière scientifique. Elle a décidé de passer de la recherche aux actes et d’œuvrer concrètement pour la planète.
« Bonjour vous êtes bien sur le portable de Deborah Pardo, je ne suis pas joignable pour le moment, je vous rappelle plus tard sauf si je suis en expédition à l’autre bout du monde. » La voix est enjouée, l’accent chantant. Belle entrée en matière pour faire la connaissance de cette scientifique, née à Marseille en 1986, enthousiaste passionnée par la nature. Ses premières explorations remontent à loin. « À 3 ans déjà, je passais des heures dans le jardin de ma grand-mère à observer les lézards et les escargots, confie-t-elle. Travailler avec les animaux, c’était comme une évidence, je voulais faire ça. » Une carrière de vétérinaire toute tracée ? Pas du tout. Son stage de troisième chez un vétérinaire ne la convainc pas. Ce sera autre chose.
Après un bac S, elle décide d’entrer dans une faculté de biologie, mais rien ne va assez vite pour la jeune femme. Du haut de ses 20 ans, elle contacte l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie (IMBE) et travaille avec eux deux étés dans le Parc national de Port-Cros sur des oiseaux marins. « Ce fut pour moi la première révélation, j’ai su à ce moment-là ce que je voulais vraiment: faire avancer la protection des espèces », se souvient-elle.
Une scientifique reconnue
L’étudiante commence alors une thèse en écologie des populations au centre de Chizé dans les Deux-Sèvres, connu pour envoyer ses chercheurs en Antarctique. Quelques mois plus tard c’est chose faite.
En janvier 2009, depuis La Réunion, Deborah embarque à bord du Marion Dufresne, le navire assurant le ravitaillement des Terres australes françaises où elle va passer trois mois à étudier les albatros, « l’une des familles d’oiseaux les plus en danger au monde », soulignet-elle. Certaines images restent gravées dans sa mémoire. « Je me souviens, au détour d’un rocher, je les ai vus, 3000 couples d’albatros à sourcils noirs devant moi. Je suis restée le souffle coupé tellement c’était beau. À la suite de ça, je me suis dit qu’il fallait que je fasse tout ce qui était en mon pouvoir pour les protéger. »
Deborah se spécialise en démographie pour avoir des données précises sur les oiseaux marins, comprendre et modéliser les raisons de leur diminution.
« Sur 22 espèces, 18 sont sur la liste rouge et il reste parfois seulement des dizaines de couples dans une espèce », expliquet-elle. Mais le monde de la science est trop lent pour cette aventurière hyperactive.
Son troisième séjour en Antarctique va agir comme un détonateur. En 2016, elle est la seule française sélectionnée pour participer à Homeward Bound, la plus grande expédition de femmes dans l’Antarctique. Un projet international, lancée par deux Australiennes, dont l’objectif est de promouvoir la place des femmes dans le monde scientifique et les inciter à travailler leurs capacités de leadership.
Elle va passer un mois sur un bateau aux côtés de 77 femmes sélectionnées dans 16 pays différents, des aventurières, aussi déterminées qu’elle, à changer le monde. « Ça m’a fait gagner 10 ans de ma vie, je me suis rendu compte de ce que je valais, et surtout du fait que je n’étais pas à la bonne place. Je me suis demandé comment je pouvais faire bouger les choses de moi-même, à partir de mes connaissances scientifiques », raconte-t-elle.
La navigation, accélérateur de leadership
De retour de cette expédition, elle quitte le prestigieux institut polaire britannique de Cambridge où elle travaille depuis quatre ans et entame une nouvelle vie à deux pas des Calanques de Marseille, sa ville natale. Une évidence s’impose : elle doit construire des ponts entre son savoir universitaire et les acteurs de l’écologie, qu’il s’agisse des entreprises, des établissements scolaires ou des collectivités territoriales. Deborah devient alors une green-entrepreneure. Tous les moyens sont bons pour agir pour la planète : son entreprise de consulting scientifique, ses formations et conférences et surtout Earthship Sisters, un programme de leadership environnemental pour les femmes, qu’elle crée en 2018 avec Nathalie Ille, une ex-mannequin devenue navigatrice. Les fondatrices sont convaincues que la transition écologique passera par les femmes et qu’il faut les aider à révéler leur envie d’entreprendre pour l’environnement.
Le programme dure neuf mois. Week-end de formation au leadership, accompagnement de la réalisation des projets puis comme point d’orgue de l’aventure, une navigation de quinze jours en Méditerranée à bord d’un voilier. « La navigation est un outil très puissant, surtout pour les femmes. Quand on est sur un voilier, on est déconnecté du monde, on laisse tout derrière nous, enfants et travail, c’est un sentiment de liberté incroyable », témoigne Deborah. Une liberté qu’elle retrouve chaque année en janvier lorsqu’elle retourne en Antarctique pendant un mois comme guide naturaliste pour la compagnie de croisières de luxe Ponant. Une soupape pour cette mère de deux enfants de 3 et 6 ans, mais surtout une façon de sensibiliser un autre public à l’environnement. « Je suis aux côtés de passagers qui ont souvent un pouvoir d’achat très élevé et une empreinte carbone énorme. Si tu réussis à faire changer l’état d’esprit de ces personnes cela peut avoir des retombées énormes. »
Prêcher la parole verte partout où elle se déplace, c’est devenu le leitmotiv de la jeune femme de 35 ans. Aujourd’hui, elle se dit plus déterminée que jamais à faire bouger les lignes pour protéger notre planète. Pour elle, aucun doute, la crise sanitaire a agi comme un accélérateur : « On ne peut plus dire qu’on n’était pas au courant, on arrête de se voiler la face et c’est très bien. »
FRANKY ZAPATA, UN AVENTURIER DES TEMPS MODERNES
Il avait réussi l’exploit de traverser la Manche sur son Flyboard®, l’inventeur marseillais prépare son nouveau défi. Et il compte bien révolutionner la mobilité. « Futur is Now », tweetait-il en mai dernier. Franky Zapata pourrait en faire un mantra.
L’homme volant est un homme pressé, un génie de l’innovation que rien n’arrête. En témoigne son dernier projet fou, Jet Racer®, une voiture volante dont le décollage est imminent. La machine est terminée, le premier vol public devait avoir lieu fin 2020 mais la pandémie de Covid 19 en a décidé autrement. Qu’importe, l’entrepreneur autodidacte en a profité pour peaufiner sa nouvelle invention, capable selon lui, « de rallier Montpellier à Marseille (120 km à vol d’oiseau) d’une traite en moins de trente minutes ».
Si certaines parties du prototype ont déjà été dévoilées, l’aspect du véhicule est encore tenu secret. « C’est un mix entre une voiture de course et un drone, confie-t-il, un châssis sans aile, propulsé par dix micro-turbo-réacteurs combinant le thermique et l’électrique. »
Actuellement, l’appareil bénéficie d’environ vingt minutes d’autonomie et vole à plus de 200 km/h, mais il pourrait dépasser les 300 km/h. De quoi épater à nouveau la planète comme Franky Zapata l’avait fait à l’été 2019.
L’exploit de 2019
Les Français le découvrent le 14 juillet, à l’occasion de la grande cérémonie nationale sur les Champs-Élysées. Ce jour-là, le Marseillais, aujourd’hui âgé de 43 ans, survole la plus belle avenue du monde à bord de son invention le Flyboard Air®, sous les applaudissements d’Emmanuel Macron, le président de la République.
Il obtient la réputation d’homme volant qui ne le quittera plus. Moins d’un mois plus tard, il confirme son statut. Le 4 août 2019, il réussit l’exploit de traverser la Manche en vingt-deux minutes à une vitesse de croisière de 140 km/h et 20 mètres au-dessus de l’eau. Cent dix ans après l’aviateur Louis Blériot, le premier à avoir franchi la Manche en volant, Franky Zapata entre lui aussi dans la légende.
Quel souvenir en garde-t-il ? « Si je ne devais garder qu’un moment fort en mémoire, ce serait celui-ci : je suis au-dessus de l’eau et je distingue enfin au loin en face de moi les falaises blanches de St Margaret’s Bay en Angleterre. Ça signifiait que j’arrivais, que j’avais réussi. J’avais la sensation du travail bien fait. »
Champion du monde
Mais avant de toucher les cieux, Franky Zapata a testé son endurance. Des mois de travail acharné, seize heures par jour, avec son équipe dans ses ateliers au Rove, près de Marseille. Car derrière ce compétiteur infatigable, se cache un boulimique de travail, curieux de tout. Déjà enfant, le petit garçon, né en 1978, passe son temps à démonter des objets pour comprendre leur mécanisme. « Petit, j’adorais bricoler, bidouiller des trucs dans le garage de mon père et j’étais fasciné par les premiers pas de l’aviation, de la conquête spatiale, des locomotives etc. », racontet-il. Dans sa jeunesse, ce fils d’un entrepreneur du BTP rêve de devenir pilote d’hélicoptère. Dyslexique et daltonien, il devra y renoncer. Il quitte l’école à 16 ans et découvre le jet-ski. Et c’est sur la mer que cet hyperactif va se révéler. En 1996, Franky Zapata obtient son premier titre de champion de France de jet-ski. Onze ans plus tard, il est sacré champion du monde dans sa discipline. « J’avais besoin de ces challenges pour me sentir vivant », confie-t-il. À l’époque déjà, le sportif de haut niveau est passionné par la mécanique, il finit même par développer ses propres engins de courses.
Entrepreneur et inventeur
En 1998, il lance une société de scooters des mers qui finit par péricliter. Pas de quoi le démobiliser, Franky garde en tête l’envie de s’envoler : « J’ai toujours dit et les gens ne me croyaient pas à l’époque : si tu peux développer un jet, tu peux développer un skateboard ou un avion, explique-t-il. Alors on a commencé à mesurer avec mes amis. On trouvait des chiffres hallucinants : une tonne de poussée. Je me suis dit, mais on peut voler avec ça! J’ai soudé des buses à une planche de wake et je suis allé sur un étang. »
Treize ans plus tard, il tient sa revanche. Il imagine alors une plate-forme propulsée par la pression de l’eau, reliée à la turbine d’un jet-ski par un long tuyau souple. Pari réussi. Son invention fascine et s’exporte dans le monde entier. Plus qu’un loisir, le Flyboard® s’inscrit comme un véritable sport à part entière. Mais très vite cet Icare du XXIe siècle veut aller encore plus loin, encore plus haut. Son but ultime, pouvoir voler indépendamment sans aucun lien avec la mer. Après des années de développement dans son atelier marseillais, et deux phalanges perdues lors de tests dans son jardin, le Flyboard Air® naît en 2016. Équipée de mini-turbo-réacteurs, la machine vole de manière autonome à 203 km/h et peut s’élever à 3000 mètres d’altitude.
Les affaires décollent elles aussi. Commercialisé depuis dix ans, le Flyboard Eau® s’est vendu à plus de 10000 exemplaires. L’homme volant emploie désormais plus de 12 salariés et l’an dernier, il a repris 100% du capital de la société Zapata industrie, dont une partie était détenue par un investisseur américain. Mais ce personnage gouailleur ne s’est pas fait que des amis, en oubliant peut-être un peu vite l’aspect réglementaire français. En 2017, la gendarmerie des transports aériens le place même en garde à vue pour non-respect des règles minimales de survol et conduite d’un aéronef sans avoir les titres nécessaires.
C’était avant les Champs-Élysées ! Peu importe, l’inventeur s’entête. Après de longues démarches, il obtient un « laissez-passer » pour son Flyboard®, un sésame pour les machines qui ne disposent pas d’un certificat de navigabilité.
Insatiable, Franky voit toujours plus grand. « Il ne s’arrête jamais », confie sa femme. Son rêve à long terme ? Changer la mobilité du futur, se déplacer sans affecter l’environnement.
« Je me suis dit: mais on peut voler avec ça ! J’ai soudé des buses à une planche de wake et je suis allé sur un étang. »
à la turbine d’un jet-ski par un long tuyau souple. Pari réussi. Son invention fascine et s’exporte dans le monde entier. Plus qu’un loisir, le Flyboard® s’inscrit comme un véritable sport à part entière. Mais très vite cet Icare du XXIe siècle veut aller encore plus loin, encore plus haut. Son but ultime, pouvoir voler indépendamment sans aucun lien avec la mer. Après des années de développement dans son atelier marseillais, et deux phalanges perdues lors de tests dans son jardin, le Flyboard Air® naît en 2016. Équipée de mini-turbo-réacteurs, la machine vole de manière autonome à 203 km/h et peut s’élever à 3000 mètres d’altitude. Les affaires décollent elles aussi.
Commercialisé depuis dix ans, le Flyboard Eau® s’est vendu à plus de 10000 exemplaires. L’homme volant emploie désormais plus de 12 salariés et l’an dernier, il a repris 100% du capital de la société Zapata industrie, dont une partie était détenue par un investisseur américain. Mais ce personnage gouailleur ne s’est pas fait que des amis, en oubliant peut-être un peu vite l’aspect réglementaire français. En 2017, la gendarmerie des transports aériens le place même en garde à vue pour non-respect des règles minimales de survol et conduite d’un aéronef sans avoir les titres nécessaires.
C’était avant les Champs-Élysées ! Peu importe, l’inventeur s’entête. Après de longues démarches, il obtient un « laissez-passer » pour son Flyboard®, un sésame pour les machines qui ne disposent pas d’un certificat de navigabilité.
Insatiable, Franky voit toujours plus grand. « Il ne s’arrête jamais », confie sa femme. Son rêve à long terme ? Changer la mobilité du futur, se déplacer sans affecter l’environnement.
FRANÇOISE COMBES, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Médaille d’or du CNRS en 2020, l’astrophysicienne tente toujours de percer les secrets des galaxies. Une quête perpétuelle pour cette scientifique à l’esprit libre.
L’astrophysique n’était pas une évidence. Une seule certitude, « faire de la recherche était la direction vers laquelle je voulais aller », raconte-t-elle. Le choix de sa thèse l’oriente vers la cosmologie, la science des lois physiques de l’Univers. Elle entame alors un travail personnel colossal. Une véritable passion est née. Lorsqu’on écoute Françoise Combes, on saisit l’urgence de connaître la réponse.
« Quand on fait de la recherche, on est sur une enquête, il y a une curiosité, on est habité par cette recherche, c’est un petit peu comme une enquête policière donc on aimerait aller jusqu’au bout, on ne voit pas le temps passer et on se prend au jeu. » Un travail dévorant ? « On ne s’arrête pas », nous confie-t-elle. Chercher l’origine de tout, une vaste quête qu’elle n’estime en rien frustrante. Une seule nécessité, choisir un sujet que l’on maîtrise pour s’engager dans la recherche. Rapidité, compétence, travail, sont les mots qu’elle emploie pour parler de son métier : « Il faut bien choisir la piste et penser qu’on va pouvoir résoudre le sujet dans les années qui viennent parce que sinon c’est trop désespérant, et se fixer des étapes, des objectifs à court terme pour voir le bout du tunnel. »
Son sujet de recherche, la matière noire, pour comprendre la dynamique et l’évolution des galaxies. Un travail « essentiel dans la compréhension de la naissance et de l’évolution des étoiles et des galaxies, y compris le rôle joué par les trous noirs supermassifs dans les centres galactiques », écrit l’Unesco.
« C’est très important de vulgariser toute la science qu’on découvre et de ne pas laisser ces connaissances qu’à une minorité de personnes. »
Une figure féminine de la science
Détentrice de nombreux prix, elle est, en 2004, la première femme astronome à être élue à l’Académie des sciences, puis en 2014, la première à décrocher une chaire d’astrophysique au Collège de France. Enfin en 2021, elle reçoit le prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science. Lorsque l’on mentionne sa médaille d’Or du CNRS, reçue l’année précédente, elle répond avec humilité :
« C’était une très bonne récompense » et souligne que le travail «de groupe » a été honoré. La lauréate se réjouit, au passage, qu’il y ait davantage de femmes parmi les prix décernés par le CNRS ces dix dernières années. La science deviendrait moderne. « L’experte de la matière noire » constate avec satisfaction que les femmes prennent aujourd’hui plus de responsabilités.
S’engager dans cette vie de recherche, un obstacle pour fonder une
famille ? Pas pour cette grande exploratrice du cosmos. « J’ai eu de la chance », dit-elle. S’organiser, ne pas se laisser déborder et réserver un peu de temps à tout, voilà comment Françoise Combes trouve son équilibre.
Sa recherche sur l’impalpable ne la rend pas chronophage, la scientifique de renom n’a pas de temps à perdre mais elle sait lâcher du lest : « Il faut avoir une partie de repos, de loisirs. On aurait tendance à travailler tout le temps car on aimerait connaître la solution à nos problèmes mais il faut se laisser des plages de repos. C’est d’ailleurs beaucoup plus productif ensuite. »
Voyage dans le cosmos
La tête dans les étoiles, quand on lui demande quel est son rapport à l’écologie, elle parle d’environnement des galaxies : « Les galaxies interagissent beaucoup entre elles, elles ne sont pas isolées, elles se forment dans les filaments cosmiques, il y a des grands vides, de grands amas, des groupes de galaxies, un peu comme des villes. Les villes humaines se rassemblent en grandes agglomérations, il y a des petits villages et ensuite de grandes étendues vides. Ce n’est pas du tout homogène dans l’univers. Donc on a des effets d’environnement. Quand on est dans un grand groupe de galaxies, les galaxies se rencontrent, elles échangent beaucoup de masse, il y a beaucoup de gaz qui a été balayé dans le vent intergalactique et donc il est très important de prendre en compte l’effet d’environnement dans la vie d’une galaxie. »
Est-elle sensible au réchauffement climatique ? « Comme tout le monde », répond-elle. Les observations se faisant maintenant à distance, il lui est possible de regarder loin dans le monde depuis son bureau. Et comme dans de nombreux secteurs, la crise sanitaire a démontré que l’on pouvait travailler autrement, limiter les déplacements pour les nombreux colloques internationaux auxquels elle participe et ainsi diminuer son empreinte carbone.
Vulgariser la science
Comprendre les travaux de recherche des autres fait partie intégrante de son métier mais elle souligne également l’importance de transmettre son propre savoir. De l’enseignement, elle retire une grande satisfaction. Propager des connaissances lui permet d’apprendre et de s’extraire de ses recherches en cours pour mieux s’y replonger. Au-delà de l’enseignement académique, des conférences et séminaires, elle estime essentiel de diffuser la connaissance scientifique au grand public, notamment à travers l’écriture d’ouvrages.
Aujourd’hui, la spécialiste de la dynamique des galaxies donne des cours grand public. « C’est très important de vulgariser toute la science qu’on découvre et de ne pas laisser ces connaissances qu’à une minorité de personnes. »
La chercheuse dont l’originalité est de mêler observation et simulation numérique travaille aujourd’hui avec son équipe sur les prochains grands télescopes. Parmi eux, le satellite Euclid qui sera lancé par l’Agence spatiale européenne en 2022. Un télescope spatial qui devrait permettre de cartographier le ciel pour identifier 12 milliards de galaxies.
Et toujours au centre de ses investigations sur les mystères de l’univers, la matière noire. De quelle matière est faite cette masse invisible ? Une question à laquelle on la sent impatiente de répondre.
Table des matières