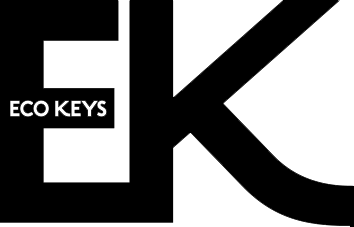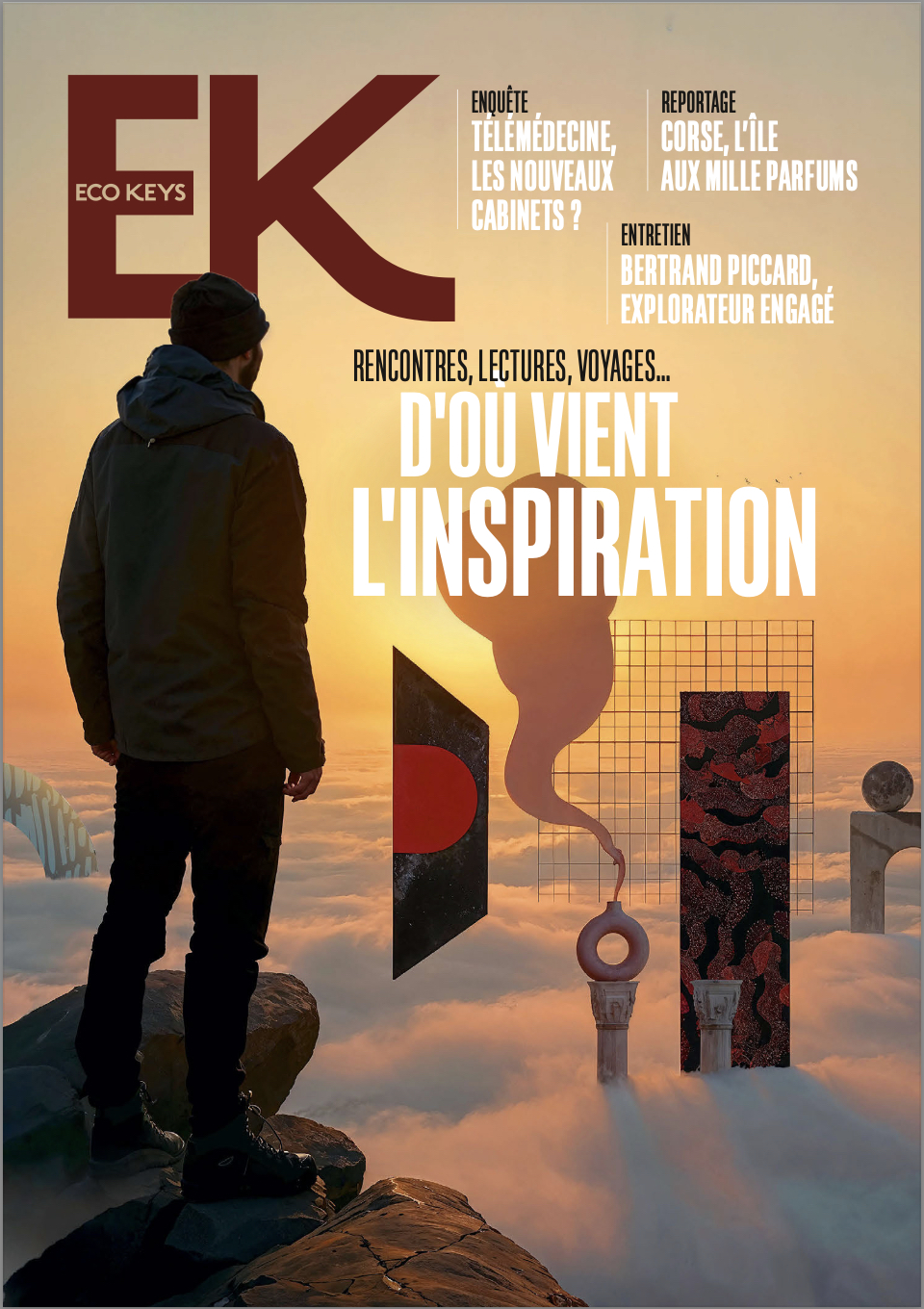Étienne Thierry-Aymé : Le thème de ce dossier, c’est « s’inspirer », « l’inspiration », cela vous inspire justement ?
Aurélie Valognes : Oui. C’est un thème qui me touche et me parle beaucoup. Car c’est un peu l’histoire de ma vie. Je me sens très sensible à tout ce qui m’entoure, m’environne… Cela a un impact direct sur mon humeur et mon inspiration. J’ai besoin de m’entourer de beauté, d’harmonie, de douceur, de légèreté et de simplicité. Et, chaque jour, je cherche ainsi ces petites choses qui vont me mettre en joie, que ce soit une œuvre d’art, la nature, le rosier de mon jardin, le lilas, le soleil et les abeilles qui bourdonnent au moment où je vous parle. Ça me réancre à chaque fois et me permet de sentir que j’appartiens à quelque chose de plus grand que moi, au vivant, et de là, je sens vraiment que c’est comme une plante qui a la bonne lumière, pour grandir. Dès lors, l’inspiration peut arriver à tout instant. J’ai d’abord besoin de cette harmonie avec ce qui m’entoure, pour ensuite me sentir comme un réceptacle, ouvert à tout ce qui peut arriver.
Il n’est jamais trop tard pour se réinventer et recommencer.
É. T.-A. : Vous avez donc un rapport très actif à l’inspiration ?
A. V. : Absolument, je ne l’attends pas, je me mets en mode réception. Mon moteur, c’est l’apprentissage. Tous les jours, je lis, je réfléchis, me nourris, cherche à trouver la bonne piste, vois ce qui résonne en moi. L’inspiration est partout, même dans la capacité à casser mes routines. Récemment, j’ai par exemple arrêté de lire pour guetter l’inspiration ailleurs. Ce qui a priori était inimaginable pour moi qui suis une droguée de la lecture… Ce temps de « vacances » sans lecture m’a permis de me remettre à écrire à la main, à cuisiner davantage, me balader dans la nature. L’inspiration, je vais donc la chercher partout, je la provoque beaucoup aussi, oui.
É. T.-A. : Dans vos romans, notamment le dernier, on perçoit aussi de plus en plus une forme de porosité entre fiction et réalité…
A. V. : Oui. Et, c’est la première fois que cette porosité est aussi marquée. Avant, j’écrivais à la troisième personne, mes valeurs transparaissaient plus discrète- ment. Même si j’étais sûre qu’à travers mes romans on pouvait savoir qui j’étais. Je me suis aussi rendu compte que parfois, il pouvait y avoir des malentendus avec certains lecteurs… La Fugue, je l’ai donc écrit avec le « je » parce que j’avais des choses à dire en tant que femme, mère, transfuge de classe, écrivaine. Ce roman comme mon héroïne, Inès, me ressemble à bien des égards, c’est certain. Au début, « la fugue », c’était celle d’une femme, moi, Inès, qui part retaper une maison pour se prouver qu’elle en est capable. Et, puis, je me suis rendu compte que je m’étais redressée, que j’avais réglé mon sentiment d’imposture, mon manque de confiance grâce au regard bienveillant d’autres personnes… C’est ainsi aussi que se sont tissées les amitiés dans le roman, comme celle avec la peintre ou l’ostréicultrice. Ces rencontres, imprévues dans la vie et le roman, ont été comme une évidence.
É. T.-A. : Avec partout une forme de dualité, entre quête intérieure et nécessité d’être avec les autres…
A. V. : Oui, c’est une phrase du philosophe Emmanuel Levinas que je fais mienne : « Le meilleur chemin pour aller vers soi passe par les autres. » Comme Inès, j’ai compris que j’étais très solitaire, que j’avais besoin de temps à moi, de silence. J’ai aussi découvert mon hypersensibilité, qui fait que le moindre bruit ou une odeur peuvent me perturber. J’ai besoin de nourrir la part artistique en moi, et qui n’intéresse personne d’autre dans ma famille, d’où le besoin d’être seule. Mais parfois, j’ai tellement besoin de partager cette attention au beau, au détail, à l’harmonie, que j’ouvre ce monde à des amis qui y sont sensibles aussi. La plupart de mes amies proches d’ailleurs écrivent ou partagent cette hypersensibilité.
É. T.-A. : Est-on obligé, selon vous, de « partir » pour se réinventer, comme toutes les femmes de ce roman ?
A. V. : Je ne sais pas si on est obligé de partir physiquement. Et, puis surtout, on n’a pas tous les moyens de le faire. C’est important de le dire aussi… Mais, en tout cas on est obligé, je pense, de casser les codes qui nous ont structurés depuis l’enfance. Il faut avoir une discussion profonde avec soi-même sur ce qui nous rend heureux ou malheureux. Je me suis rendu compte par exemple que j’avais toujours entendu que la famille et le travail étaient les choses les plus importantes, mais je n’étais pas toujours très bien avec ça. J’ai donc désormais décidé de diviser mon temps en quatre : famille, travail, amis, un temps pour moi. C’est essentiel, même si la société n’y est pas toujours préparée, surtout quand on est une mère. Se réinventer, c’est aussi ça, réinventer son modèle de couple, accep- ter qu’on ne soit pas la même personne à 20 ans qu’à 40. Ce n’est pas partir « contre » les autres, contre son mari, contre ses enfants, mais « pour » soi. La clé est de se connaître, de savoir ce qui nous fait du bien, et de se moquer des injonctions de la société.
É. T.-A. : Cette capacité à se réinventer, c’est lié aussi à l’écriture chez vous ?
A. V. : Je ne ferais pas ce parallèle. C’est plutôt lié à l’impression d’avoir déjà eu 1 000 vies. J’ai été prof de gymnastique rythmique sportive (GRS), j’ai grandi dans une HLM, j’ai été en Cité U pour suivre mes études à Reims, j’ai vécu à Genève, à Paris, en Italie… J’ai eu deux enfants. Et, d’un coup, parce que rentrée en France et devenue écrivaine, que j’ai trouvé ma voix, il faudrait ne plus me poser de questions ? Certes, je ne me vois plus faire autre chose qu’écrire, mais pourquoi ne pas envisager un jour l’écriture d’un scénario ? Ou chanter ? Ou apprendre le pia- no ? Je joue déjà de la guitare. En fait, je laisse tout ouvert à ma fibre artistique, et tout vient me nourrir. Tous les arts me sont vitaux et nécessaires.
É. T.-A. : Comment se déroule le processus créatif chez vous, de l’idée à sa réalisation ?
A. V. : Comme nombre d’artistes et d’écrivains, je ne pense qu’à ça tout le temps. Quand on est passionné par l’écriture, on est tendu vers cet objectif. Actuellement, je réfléchis au prochain roman qui sortira en 2026, et je n’ai absolument rien de concret. C’est comme un tableau lointain, sans couleurs ni formes précises. Je peux avoir un début de titre ou un mot qui me plaît, et je vais lire des choses sur ces thèmes. L’inspiration peut venir d’un mot dans la presse, d’un personnage, d’une histoire, tout vient d’un coup. Quand j’écris, j’ai l’impression de vider tout ce qu’il y a en moi et de me remplir de nouvelles choses. Mes lectures actuelles sont très variées, de la spiritualité à la philosophie, en passant par le bon goût.
É. T.-A. : Votre manière d’écrire a-t-elle évolué avec le temps ?
A. V. : Oui, à une époque, j’étais très organisée. Je traçais l’ossature du plan sur Excel, et je m’isolais deux semaines pour le premier jet. Maintenant que j’écris au « je », je suis incapable de me projeter ainsi, car c’est mélangé à mes ressentis.
É. T.-A. : Il y a aussi une forme de science du titre chez vous…
Comment les choisissez-vous ?
A.V.: Il n’y a pas de règle. Au début, mes titres étaient empruntés à des expressions familières comme Mémé dans les orties. Mais, j’ai eu l’impression à un moment donné de me caricaturer. Ensuite, j’ai laissé les mots s’assembler comme Le Tourbillon de la vie ou La Ritournelle. Pour mes trois derniers romans plus in- times, j’ai abandonné les titres-expressions. L’ Envol, qui évoque la relation mère-fille, a été trouvé au dernier moment, alors que mon roman La Fugue s’est imposé comme une évidence avec mon éditrice dès le début.
É. T.-A. : Vous partez donc à chaque fois d’une question, puis vous amassez de la matière pour écrire votre histoire ?
A. V. : Exactement. Avec La Fugue, la question de départ était : quand on arrive à la moitié de sa vie et qu’on a tout mis en place – mari, maison, enfants –, a-t-on le droit de tout recommencer, de se réinventer, de tout brûler pour repartir de zéro ? Le petit train qui avance, journée après journée, moi ça m’angoisse. Et, je me suis rendu compte que je n’étais pas la seule…
Certains vont à la plage, moi, je m’enferme chaque année au mois d’août, c’est mon mois d’écriture…
É. T.-A. : Vous avez donc une phase de maturation, puis vous vous astreignez à écrire un premier jet, c’est bien ça ?
A. V. : Oui, là où certains vont à la plage, moi, je m’enferme chaque année au mois d’août, c’est mon mois d’écriture. C’est le moment où je ne me laisse pas le choix : je dois ressortir avec un premier jet. Pour La Fugue, l’été dernier, dans ma nouvelle maison, j’ai été très prolifique : en trois ou quatre semaines, j’avais peut-être 800 pages, qui contenaient d’autres idées de romans, des sujets qui me travaillent encore, et reviendront tant que je ne les aurai pas approfondies ; et 150 sur les raisons du départ d’Inès, qui n’ont finalement pas été gardées dans le roman, mais qui m’ont aidée à la comprendre. De retour chez moi après les vacances, je reprends ma vie de famille avec mes deux enfants à déposer à l’école, et mon premier jet… Tellement mauvais que j’ai parfois honte en me relisant. Je me dis « qu’il n’y a rien à sauver ». Et puis quand même, je me dis « non, j’aime cette idée, j’aime ce truc-là, si on le déplaçait avant, peut-être que ça aiderait ». C’est vraiment se confronter à sa propre nullité, à son imperfection, à sa médiocrité et malgré tout se dire : « J’ai déjà parcouru un bout de chemin, je ne vais pas m’arrêter là, je vais poursuivre mes efforts pour donner forme à ce texte, à cette histoire. Je le dois presque à mon personnage, et à tous les lecteurs et lectrices qui s’y retrouveront. » Donc oui, c’est au moins quatre à cinq mois de réécriture intense à s’arracher les cheveux, où franchement je ne fais que piétiner. J’avance comme une fourmi, mot après mot, je passe de 5% à peu près du roman, à 8% puis à 12 %. Et puis vient novembre, et je me dis que je n’y arriverai pas. Et, d’un coup, le lendemain, je suis à 85 %. Mais j’adore ça, écrire, écrire, écrire, c’est ma passion absolue. C’est un processus très angoissant, mais, une fois terminée, la récompense est absolue, je suis fière d’avoir donné le maximum.
Ce qui est vrai, c’est que je doute toujours d’avoir “la” bonne idée. Mais les idées, j’en ai plein.
É. T.-A. : Vous ne craignez jamais la page blanche ou la panne d’écriture ?
A. V. : Pas vraiment. Non. Ce qui est vrai, c’est que je doute toujours d’avoir « la » bonne idée. Mais les idées, j’en ai plein. J’ai l’impression que même si on imposait à tous les auteurs un thème unique, comme par exemple « les nuages », nous serions toutes et tous capables d’accou- cher d’un texte extraordinaire, car nous portons tous au fond de nous, quelque chose à exprimer, à crier. Après chacun est plus ou moins mort de faim, avec un élan et une détermination, une volonté. J’ai pour ma part un feu intérieur, comme une forme d’hyperactivité, intérieure, contemplative. Et, j’ai besoin que ça sorte, que cela résonne avec les lecteurs. L’ins- piration est toujours la confirmation du roman que je vais finir par écrire, et je la trouve quasiment toujours dans les ren- contres avec les lecteurs en librairie. Leurs questions, leurs retours, viennent conforter ce que je pressentais et me donnent l’élan d’écrire.
É. T.-A. : Et quel est le sujet qui pourrait vous pousser en ce moment ?
A. V. : Dans ce monde et cette période hyper agressive que nous vivons, un mot revient souvent chez les lecteurs et les lectrices, c’est le mot de douceur. Je me dis « tiens ».
É. T.-A. : La transmission est également un thème central chez vous, n’est-ce pas ?
A. V. : Déjà, merci pour cette question, car ce mot de transmission résume en effet certainement le mieux l’ensemble de mes livres. J’ai commencé à écrire, et je pense que ce n’est pas un hasard, après la naissance de mon premier enfant et la perte d’une cousine de 32 ans d’un cancer du sein. On se dit alors : « Ok, donc tout peut vraiment s’arrêter du jour au lendemain ? » « Et, concrètement, qu’est-ce qu’on laisse derrière soi ? » Quelles sont ses valeurs ? » Chaque roman est comme « la dernière chose que j’avais à dire sur Terre ». Ce qui devrait évidemment se terminer par « aimez-vous les uns les autres ». Tous mes romans parlent de ça, de ce que l’on apprend de nos aînés, de nos amis, de ce que nous transmettons à nos enfants, de ce qu’ils nous apprennent eux aussi. La transmission, c’est dans tous les sens.
É. T.-A. : Le fait d’être devenue, à votre tour, une source d’inspiration, cela vous inspire, vous touche ?
A. V. : Après plus de dix ans d’écriture, c’est incroyable, oui, de faire partie de la « famille » des lecteurs et des lectrices. Quand ils me disent qu’une phrase a résonné en eux, que je leur ai donné le cou- rage de prendre la plume, et ça arrive beaucoup plus souvent depuis que j’écris à la première personne, c’est certainement parmi mes plus beaux cadeaux. Ça me pousse à continuer à montrer qu’on peut y croire et se réinventer. Mon parcours, personne n’y croirait, si on l’écrivait dans un roman : je n’ai pas suivi de cursus littéraire, je ne connaissais pas le milieu, et je viens d’une classe sociale populaire. Mais, les livres m’ont ouvert des portes que je n’aurais jamais pu franchir, et cela grâce à ma mère qui m’emmenait à la médiathèque tous les mercredis. Il y a dix ans, j’avais presque oublié mon rêve de petite fille de devenir écrivaine… Et puis, un jour, la vie a fait que je me suis dit « c’est maintenant ou jamais ». Je m’y suis mise, j’y ai cru, j’ai trouvé le système de l’autoédition. Ça a cartonné, et les éditeurs sont venus me chercher. Mon premier roman, Mémé dans les orties, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Comme quoi, il n’est jamais trop tard pour se réinventer et recommencer.